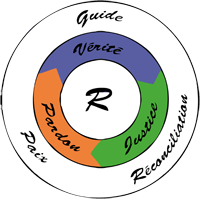Xavérine et Karinda
Un symbole de réconciliation authentique
Un signe d’espérance pour le peuple rwandais
Photo B. Guillou, 2005
Benoît Guillou, Le pardon est-il durable? Une enquête au Rwanda
Benoît Guillou est journaliste et docteur en sociologie (EHESS). Il a notamment exercé les fonctions de rédacteur en chef du magazine d’Amnesty International en France. Après la guerre et le génocide de 1994, il a effectué plusieurs visites au Rwanda, pour enquêter non pas sur la situation des droits de l’homme, mais sur le pardon et la réconciliation.
En 2014, il a publié le livre: Le pardon est-il durable? Une enquête au Rwanda. Le chapitre 7 présente l’histoire d’une relation de pardon entre une mère (Xavérine) et l’un des assassins de ses fils (Karinda).
Gaël Faye, l’artiste franco-rwandais chante son « Petit pays », le Rwanda, pendant que son compatriote français Benoît Guillou y mène son enquête sur le pardon et la réconciliation.
1. Résumé du chapitre 7
Xavérine est une femme rwandaise. En avril 1994, dans la commune de Musha au Rwanda, en pleine guerre, son mari et ses trois fils sont assassinés par une bandes de tueurs Hutus de sa colline et des environs, des exécutants de la propagande politique visant les massacres et l’extermination des Tutsis.
Benoît Guillou qui l’a rencontrée après la guerre, raconte:
« Cette perte la plonge dans un état de prostration totale. Le chagrin et le néant l’envahissent: « Ma vie n’a plus de sens ». Désespérément seule, le suicide lui paraît comme son unique horizon. Un matin, elle se dirige vers le lac Muhazi à proximité de son domicile avec ses trois filles [...] En chemin, elle rencontre inopinément la femme qui l’avait accueillie et protégée pendant les premiers jours des massacres sur la colline. Cette dernière ne remet pas en cause son projet suicidaire mais lui suggère de confier ses enfants. Xavérine acquiesce ».
Elle va dans le lac, elle veut se noyer mais n’y arrive pas. La mort ne veut pas d’elle. « Au milieu du lac, j’ai alors senti que je devais demander pardon à Dieu pour cette tentative de suicide », dit-elle. Elle retourna alors chez la femme qui hébergeait ses filles.
L’auteur du livre poursuit:
« Xavérine a perdu tous ses points d’appui. Dieu est illusion ou impuissance [...]. Comme pour d’autres rescapés, l’heure est au règlement de compte et à un rapport marchand avec Dieu.
Parfois, je m’adressais à Dieu pour le supplier de me venger de la mort de mes enfants, je lui promettais de le reconnaître comme Dieu s’il parvenait à me consoler [...] Pour faire arrêter les gens, je n’ai épargné personne sur notre colline, il reste très peu d’hommes [ de faux témoignages conduisent indifféremment innocents et coupables en prison]. Si on m’avait même demandé de les tuer, je l’aurais accepté. »
[...] Son adhésion au Renouveau charismatique catholique représente un élément essentiel pour comprendre sa trajectoire et les changements à venir. Elle va mobiliser de nouvelles ressources l’entraînant à faire un travail sur elle-même, notamment sur sa façon de lire sa vie et de désigner le « mal ». Sa conversion l’amène même à dire: « J’étais en train d’agir de la même manière que les assassins de ma famille ». Elle s’appuya fortement sur la Bible, rendit visite aux prisonniers. Elle alla voir le ministère public (Parquet de la République) pour rencontrer les personnes qu’elle avait fait emprisonner et leur demanda pardon. Elle dit: « A tout ce monde-là, j’ai accordé le pardon. Je ne suis pas contre la justice, en leur pardonnant, je n’ai fait qu’obéir à ma conscience. Les instances judiciaires n’ont qu’à poursuivre leurs investigations. »
Le 8 février 2001, elle livra son témoignage sur le pardon au cours d’une manifestation de grande envergure qui clôturait le jubilé de l’an 2000 et le centenaire de la présence de l’Église catholique au Rwanda. Après avoir donné ce témoignage, Xavérine a rencontré beaucoup de difficultés. Elle a reçu beaucoup de menaces des rescapés du génocide, assoiffés de vengeance. Elles lui reprochaient d’avoir pardonné à ceux qui ont tué ses enfants, d’avoir demandé pardon à ceux qu’elle avait fait emprisonner injustement et de rendre visite aux prisonniers et à leurs familles. Mais elle est restée forte et convaincue que « la paix ne peut venir que du pardon ».
En avril 2003, un homme appelé Karinda habitant la même colline que Xavérine lui demande un rendez-vous pour aborder un sujet important. « Il n’en dit pas davantage mais précise qu’il souhaite qu’il y ait d’autres personnes. Xavérine honore cette demande et l’invite le jour même chez elle en présence d’un couple de voisins Hutus ».
Un de ces voisins restitue les paroles de Karinda:
« J’ai eu des problèmes dans mon corps, maintenant je viens t’en parler. Je t’ai fait du mal. Je viens te demander pardon parce que je t’ai offensée. J’ai tué ton enfant. Maintenant, je viens te demander pardon, parce que je me suis senti très mal. Je ne pouvais plus me coucher, je ne dormais plus, je ne parvenais plus à manger ». Xavérine a répondu: « Le pardon, je te l’accorde ». Aussitôt après, ils se sont embrassés.
L’épouse de Karinda ajoute:
« Je trouvais Xavérine forte, par contre quand Karinda a fini de parler, de dire qu’il avait tué l’enfant, moi j’ai eu peur. Il a dit: « l’enfant, je l’ai frappé avec une sorte de gourdin et il a levé son petit bras comme ça [pour se protéger] ». A ce moment-là, je me suis mise à trembler ».
L’enquêteur affirme que les propos de cette femme manifestent la sincérité de Karinda. En effet, comme celui-ci le dit lui-même, il faut reconnaître que c’est vraiment un pardon « authentique ».
Après cette rencontre, Karinda et Xavérine témoignent.
Karinda:
« Avant que je ne demande pardon, j’étais toujours poursuivi par ce que j’avais fait. Je pouvais passer trois jours sans manger alors que j’avais de quoi manger, mais je n’avais pas d’appétit. Je pouvais passer à côté de toi, sans te voir, sans te saluer, comme un somnambule. J’étais obsédé par ce que j’avais fait. C’était comme un film sans fin ».
[...]Je suis allé chez elle, je lui ai dit: « Je viens pour te demander pardon et pour te parler de ma responsabilité dans la mort de tes enfants. Je me remets entre tes mains. Tu peux me pardonner ou ne pas me pardonner ». J’étais sur le point de craquer, j’allais perdre la tête. Je ne me reconnaissais pas, c’était plus fort que moi ».
Après le génocide, Karinda a été accusé par d’autres rescapés d’avoir tué un neveu de Xaverine et placé en détention, puis libéré sept années plus tard. Il fut condamné à trois ans d’emprisonnement par la juridiction communautaire Gacaca mais il resta en liberté parce qu’il avait déjà passé 7 ans en prison. Lors de l’entretien avec l’enquêteur, celui-ci lui demande si, à l’époque, il ne redoute pas de retourner en prison après cet acte de repentance.
Il répond:
« Non, j’avais la crainte de l’enfer. En demandant pardon, je ne pensais pas à la loi. Elle ne fait pas asseoir le pardon dans les cœurs. Moi, j’avais besoin d’être libéré. J’étais prêt à accepter toutes les conséquences ».
Xavérine témoigne aussi:
« Notre pardon se concrétise par les visites que nous effectuons l’un chez l’autre, par le partage de la bière de sorgho quand on en a, des travaux manuels qu’on peut faire ensemble, et surtout, quand l’un d’entre nous tombe malade, l’autre donne un coup de main en travaillant son champ. On s’entraide et quand on se rencontre en chemin, on se salue, on se serre la main comme des gens en bonnes relations. Ça donne la joie ».
L’enquêteur décrit ensuite cette relation entre Xavérine et Karinda comme suit:
Xavérine et Karinda entretiennent à présent une relation affective: « Je l’appelle maman ». Xavérine le nomme: « Mon fils »! Ils partagent une économie mystique, un répertoire d’action commun et une vie communautaire.
Et, ils ont poursuivi leur engagement pour la réconciliation authentique au niveau social et politique. L’auteur du livre donne un exemple:
Un jour, « Xavérine et Karinda se rendent à la prison centrale de Kigali (PCK). Parmi les détenus, il y avait trois femmes arrêtées sur la base d’accusation de Xavérine. Le Renouveau charismatique – dont elle fait partie – demande l’autorisation d’animer une célébration eucharistique en présence de deux invités de Musha. A la fin de la célébration, Xavérine s’exprime pour demander pardon à ces trois femmes, elle se sent coupable de les avoir dénoncées sur une base qu’elle juge à présent insuffisante.
Le membre de la communauté d’Emmanuel relate ce moment précis:
Elles ont pris la parole à tour de rôle, elles disaient: « Nous aussi, si nous avions vécu ce que tu a vécu, si nous étions à ta place, nous pensons que nous aurions fait pire ». Elles se sont embrassées, elles ont pleuré: « Même si nous sommes en prison, nous savons qu’un jour nous serons libérés ». Xavérine a dit: « Si cela relevait de mon pouvoir, vous seriez libérées tout de suite, mais il faut suivre la procédure normale ».
En octobre 2001: la population doit élire les juges « intègres » appelés à siéger dans les juridictions communautaires appelées Gacaca. Xavérine est élue puis désignée par les autres juges pour assurer la présidence de la juridiction au niveau de sa cellule (la plus petite entité administrative sur la colline). Les audiences commencent en 2005. Mais, comme dit l’enquêteur, le fait de ne pas prendre en considération les exactions dont ont été victimes les Hutus après le génocide constitue un autre motif de désaccord (les juridictions Gacaca n’étant compétentes que pour les crimes de génocide). Xavérine part à nouveau de son expérience personnelle pour plaider en faveur d’une justice impartiale:
«Je pense personnellement que ceux qui ont été chargés faussement ont le droit à ce que les accusateurs leur demandent aussi pardon durant ces gacaca. Ce serait une occasion pour moi de parler du cas de ces femmes que j’ai dénoncées et fait arrêter. Elles restent toujours en prison alors que je me suis fiée aux échos. La situation de ces femmes me trouble. La miséricorde divine n’a pas de limite, je garde espoir que chacun puisse être éclairé ».
L’auteur du livre recevra plus tard en 2009 une information comme quoi « les juridictions gacaca sous la présidence de Xavérine furent considérées comme un « modèle » par la population et les autorités au niveau du secteur de Rutoma [...] »
Niyomugabo Philémon chante: « Soyons les artisans de paix »
2. Commentaires
Cette enquête et ces témoignages prouvent encore une fois que mon plaidoyer pour un droit-guide de la réconciliation est fondé.
Dans ce plaidoyer publié déjà en 2002, j’ai cité un autre témoignage d’une Sœur ayant pardonné à un homme, en prison, qui a tué son papa (page 27 version internet). C’était un récit raconté par un prêtre rwandais, l’abbé Jean Baptiste Bugingo, lorsqu’il disait qu’il y avait (en 2001) 300 prisonniers qui ont écrit aux familles de leurs victimes pour leur demander le pardon et les familles sont venues et se sont réconciliées. Et je pense qu’il s’agit bien de Sœur Geneviève que Benoît Gillou parle dans son livre (pages 96 à 99) vu la ressemblance des éléments de ces deux récits qui se recoupent. J’affirmais que si des centaines de prisonniers parviennent à se réconcilier avec leurs victimes, le fait de rester en prison n’a plus de sens, au point de vue social et juridique, car ils ne représentent plus aucun danger pour la société, le but ultime poursuivi ayant été atteint ; c’est-à-dire : le reclassement psychosocial. Pour pareils exemples de réconciliations, la société n’a plus aucun intérêt à continuer d’encombrer les prisons de personnes qui demandent pardon pour les infractions commises, encore que les victimes acceptent de leur offrir ce pardon. Si on admet que «lorsqu’un homme blesse un autre homme, c’est toute la communauté humaine qui est atteinte », il faut aussi accepter que « lorsqu’un homme est pardonné par un autre homme, c’est toute la communauté qui est réconciliée ». Si l’on acceptait que «la justice pénale se justifie surtout par la nécessité de prévenir la répétition de conduites criminelles, tout en s’efforçant de réconcilier la société avec ceux de ses membres qui ont méconnu des interdits fondamentaux », ces 300 prisonniers seraient libérés, sans attendre la fin du procès, évidemment au cas où la loi du pardon serait prévue dans la législation nationale. Ce qui n’empêcherait pas la poursuite du jugement pour la réparation du préjudice.
D’autre part, il faut affirmer, avec vigueur et conviction, que des Tutsi et des Hutu, rescapés ou non et responsables ou non du génocide, n’avaient aucune raison de menacer Xavérine et Karinda pour leurs actes de pardon et de réconciliation en faveur de leur paix mais aussi de la paix sociale. Comment expliquer ces menaces alors que la politique nationale prône la réconciliation? Ces rwandais auraient-ils préféré que Xavérine et Karinda se suicident? Je ne crois pas. Ces derniers n’avaient-ils pas les droits au pardon mutuel, c’est-à-dire demander pardon et pardonner, pour pouvoir revivre ensemble en paix? Comme d’autres droits humains universels, ces droits à la réconciliation (uburenganzira ku bwiyunge) devraient aussi être reconnus en droit national et même international. Voilà pourquoi, depuis 2001, je plaide pour l’instauration d’un droit-guide de la réconciliation.
Dans ce récit, un autre cas très parlant est celui de ces prisonniers qui ont été dénoncés sur base des fausses accusations de Xavérine. Si cette dernière a reconnu ses torts et leur a demandé pardon, pourquoi la justice continuait-elle de les garder en prison? Dans quel intérêt? L’intérêt pour qui alors que même Xavérine était « troublée » par cette situation? S’ils ont été emprisonnés suite aux dénonciations de Xavérine, pourquoi celle-ci a-t-elle été privée de son droit de les faire libérer après avoir avoué que ses accusations étaient fausses? Difficile à comprendre.
Suite à son pardon exemplaire, Xavérine a eu la confiance non seulement de la population car elle a été élue comme juge de la juridiction Gacaca, mais aussi les juges lui ont fait confiance en la désignant présidente de cette juridiction (instituée par la Loi organique n° 40/2000 du 26/01/2001 portant création des « Juridictions GACACA » et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crime contre l’humanité, commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994).
La loi portant création des Juridictions Gacaca a suscité beaucoup de réactions tant positives que négatives dans les milieux privés et publics, mais ces différentes opinions ont enrichi les débats sur les thèmes du pardon et de la réconciliation. Si alors aujourd’hui, comme le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) qui va fermer définitivement ses portes, ces juridictions Gacaca n’existent plus, car leur mission est terminée, quelle nouvelle justice envisage-t-on pour continuer à promouvoir et favoriser la réconciliation rwandaise? La médiation et la justice réparatrice ne sont-elles pas des modes de résolution des conflits appropriés pour la résolution des conflits rwandais? C’est cela que propose ce Guide de la Réconciliation pour la Paix (Rappelons que ce projet a été créé aussi en 2001, comme la Loi sur les Juridictions Gacaca qui, elle, n’est plus en vigueur).
Une instance de médiation, avec Xavérine et Karinda comme médiateurs ou conciliateurs, pourrait alors devenir aussi un modèle d’une bonne justice pour la réconciliation.
Etes-vous, comme moi, avec Xavérine et Karinda pour la réconciliation authentique? Si oui, mobilisons-nous alors ensemble.
Suivons le Guide!